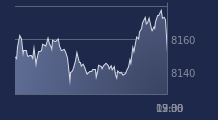(BFM Bourse) - Goldman Sachs s'est livrée, dans une récente, note, à un exercice riche d'enseignements. La banque a calculé l'exposition des groupes du S&P 500 aux pays non américains et a remarqué que les 50 sociétés les plus exposées à l'international surperforment à la fois l'indice dans sa globalité et les entreprises qui ont des revenus concentrés sur les États-Unis. Ce qui tient à la faiblesse du dollar.
Avec l'incertitude provoquée par Donald Trump sur les surtaxes douanières, Wall Street a perdu de sa splendeur. Le S&P 500, son indice de référence s'adjuge, certes, 7% (*) depuis le début de l'année, grâce à de bonnes performances en juin et sur le début de juillet. Et les investisseurs ont appris à relativiser voire minimiser les menaces douanières du président américain.
"Le marché pense généralement qu'il s'agit d'une tactique de négociation et qu'il est peu probable que de tels droits de douane soient appliqués", a commenté lundi Deutsche Bank.
Il n'empêche que Wall Street fait pâle figure face à plusieurs marchés européens. Le FTSE 100 de Londres s'adjuge 9,8% depuis le début de l'année, le FTSE Mib de Milan prend 17,4% l'Ibex 35 de Madrid grimpe de 20,7%, et le DAX 40 de Francfort avance de 22,4%.
>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading
Environ 28% des revenus du S&P 500 générés à l'étranger
Comme nous l'avons expliqué à de multiples reprises, la sous-performance des marchés américains s'expliquent avant tout par la politique économique de Donald Trump.
Les surtaxes douanières, mais aussi les incertitudes autour du projet de loi de finances américain (le fameux "big, beautiful, bill") et les menaces du président américain vis-à-vis de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), ont provoqué un certain désamour des investisseurs. Ces derniers ont modifié l'allocation de leurs portefeuilles en réduisant fortement leur exposition aux actifs américains, comme les actions, aux bénéfices d'autres zones géographiques.
Toutefois, la performance du S&P 500 cache des disparités. Ce que montre une récente note de Goldman Sachs.
Dans une étude publiée lundi 14 juillet, la banque a passé au crible l'exposition des pensionnaires de l'indice (en termes de chiffre d'affaires) à leur pays domestique (les États-Unis, donc) et à l'étranger. Pour ce faire, la banque a épluché les rapports boursiers des différentes sociétés.
Goldman Sachs en a tiré une série de données très intéressantes. Par exemple, la banque a calculé que l'exposition globale du S&P 500 (sur la base de quelque 17.000 milliards de dollars de chiffres d'affaires) à l'étranger s'établissait à 28% et que les ventes en Chine ne représentaient que 2% (un chiffre à relativiser toutefois car beaucoup de compagnies évoquent en réalité leurs revenus générés en "Asie-Pacifique). Pour l'Europe, le taux tombe à 5%.
Par ailleurs, seulement un secteur dérive plus de la moitié de ses revenus à l'étranger, à savoir la tech avec un taux de 56%, tiré par les semi-conducteurs (67%).
50 sociétés dont Netflix et Meta
Le point le plus saillant de la note de la banque américaine est toutefois autre. Depuis le début de l'année, à la date de publication du rapport, les entreprises du S&P 500 ayant la part de leurs ventes la plus importante à l'étranger surperforment nettement le S&P 500 dans sa globalité, et encore plus les sociétés dont les revenus sont concentrés aux États-Unis.
Goldman Sachs a retenu 50 sociétés avec les revenus les plus internationalisés. L'exposition médiane de ces entreprises à l'étranger est de 70% Parmi ces 50 groupes du S&P 500 figurent Meta (64% de revenus à l'étranger), Netflix (59%), Mastercard et Visa (70% et 59% respectivement) Qualcomm (75%), Broadcom (75%), Philip Morris International (100% car les activités américaines historiques de Philip Morris sont regroupées chez la société Altria) ou encore Estée Lauder (75%) et Mondelez (74%).
Pour les 50 sociétés les plus "domestiques" la banque a notamment sélectionné Verizon (0%) Wells Fargo (0%), ou la chaîne de magasin Target (0%). L'exposition médiane de ces entreprises aux pays hors États-Unis est de 0%.
Goldman Sachs observe que les actions des 50 groupes du S&P 500 les plus "internationaux", affichent une performance boursière de 10,8% sur l'ensemble de 2025. C'est plus que l'indice (7,2% à la date de publication de la note de la banque) et bien plus que les 50 sociétés les plus "domestiques", qui ne prennent que 3,6% sur la même période.
Ce qui s'avère d'autant plus marquant que, sur une longue période, soit depuis 2007 dans la note de Goldman Sachs, les performances ont tendance à se rapprocher (+466% pour les 50 entreprises les plus internationalisées, +480% pour le S&P 500, +376% pour les entreprises "domestiques")
On notera au passage que les sociétés avec le plus de ventes à l'étranger affichent des multiples de valorisation plus généreux. Selon Goldman Sachs, leurs actions s'échangent en moyenne 22,8 fois le bénéfice par action sur douze mois, contre 19,8 fois pour le S&P 500 et 16,3 fois pour les sociétés "domestiques". Souvent, les groupes à l'international peuvent évoluer sur des marchés émergents ou des secteurs en forte croissance, ce qui peut justifier des valorisations plus élevées.
Pas forcément des victimes
Pour revenir à la performance de 2025, comment expliquer que ces 50 sociétés avec des revenus très internationalisés fassent mieux que les autres? L'idée paraît contre-intuitive au vu des tensions commerciales actuelles, qui devraient, au contraire, amener les investisseurs à privilégier les sociétés avec une forte exposition locale.
Précisons au passage qu'au vu de la diversité de l'échantillon en termes d'entreprises (50 donc) et des secteurs représentés (onze) il n'est pas possible d'invoquer une logique particulière, s'appliquant aux actions d'un compartiment précis. Même si Netflix, McDonald's et Philipp Morris International font partie des valeurs que nous avions identifiées qui résistent très bien à la tempête douanière, dans un précédent article.
Deux sources d'explication doivent être mises en avant. Tout d'abord il convient de rappeler que les surtaxes américaines ne menacent pas directement les groupes américains qui réalisent le gros de leurs revenus à l'étranger. Ceux-ci sont davantage exposés aux risques de ripostes commerciales de la part des partenaires des États-Unis, comme la Chine.
Les "victimes" directes des droits de douane américains sont en réalité des sociétés qui importent des matières premières, des composants, ou des biens de l'étranger pour les vendre sur le sol américain. Ce qui est le cas, par exemple, des constructeurs automobiles.
Bernstein écrivait en novembre que Stellantis et Volkswagen importaient du Mexique et du Canada environ 40% des volumes vendus aux États-Unis, un taux qui tombe à 30% environ pour General Motors et environ 25% pour Ford. Autre exemple: Nike. Le producteur d'articles de sport conçoit 95% de ses chaussures dans trois pays étrangers (Vietnam, Indonésie et Chine), un taux qui passe à 61% pour les vêtements (au Vietnam, en Chine et au Cambodge) selon Bank of America.
L'avantage d'un dollar bas
La plus importante explication de cette surperformance des sociétés internationalisées est livrée par Goldman Sachs elle-même. "L'affaiblissement de 7% depuis le début de l'année du dollar américain pondéré en fonction des échanges commerciaux a soutenu les performances des actions des entreprises américaines tournées vers l'international", avance-t-elle.
La faiblesse du dollar favorise les exportations américaines à l'étranger. Par ailleurs, elles permettent des gains de changes. Plus le billet vert est bas face aux autres devises, plus les revenus générés par les sociétés américaines dans ces dernières devises sont élevés une fois convertis en dollars.
"C'est de là que vient la véritable impulsion", a déclaré à CNBC Art Hogan, stratégiste de marché chez B. Riley Wealth Management. "Pendant longtemps, la force du dollar a été un facteur défavorable. C'est devenu un vent porteur cette année, et cela va commencer à se manifester lorsque nous verrons les résultats d'entreprises", a-t-il ajouté.
Depuis le début de l'année le dollar souffre, en effet face aux autres devises. Le billet vert chute de 10,7% face à l'euro et l'indice DXY, qui mesure la performance du dollar face à un panier de grandes devises, plonge de 9%.
Nous avions détaillé, il y a peu, les raisons de la chute du "roi dollar". En raison de la désaffection des investisseurs pour les actifs américains expliquée au début de cet article, les opérateurs de marché ont allégé leurs positions sur des titres américains (actions, obligations) pour réinvestir dans des actifs étrangers.
Ce mouvement revient, in fine, à vendre des dollars pour acheter d'autres devises. Et les incessantes pressions de Donald Trump sur le président de la Fed, Jerome Powell, n'ont fait que renforcer la tendance.
Deutsche Bank redoutait en avril "une crise de confiance" sur la devise américaine. En juin, dans ses prévisions économiques et de marché pour le second semestre, la banque allemande a estimé que, peu importe les futures décisions de l'administration Trump "le mal est fait" sur le dollar. "Seul l'avenir nous dira dans quelle mesure le dollar a été endommagé", insistait-elle. La banque allemande pense que le dollar chutera encore et anticipe un eurodollar à 1,20 à la fin de l'année contre de 1,16 actuellement.
(*) Tous les cours évoqués dans l'article ont été arrêtés à la clôture européenne de jeudi soir.