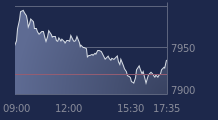Comment le secteur minier peut contribuer à réduire le déficit énergétique en Afrique
Pour investir en Afrique subsaharienne, l’un des plus grands problèmes qui se posent aux compagnies minières est l’accès à l’électricité. Dans cette région, la plupart des pays n’arrivent déjà pas à satisfaire les besoins des ménages. Cette situation a souvent contraint les sociétés minières à choisir l’option la moins risquée mais la plus coûteuse : installer leurs propres sources d’approvisionnement. Dans ce contexte, la Banque mondiale préconise, pour certains pays, une intégration des compagnies minières dans la mise en œuvre des politiques nationales de développement énergétique. Arguments.
Des besoins gigantesques
En Afrique du Sud, deuxième économie du continent derrière le Nigeria, l’un des secteurs les plus affectés par la crise que traverse depuis plusieurs mois la compagnie nationale d’électricité, l’Eskom, est l’industrie minière. Pour cause, les mines consomment près du tiers de l’énergie distribuée dans le pays par la société nationale qui figure pourtant dans le top 7 mondial des compagnies électriques en matière de production.
Eskom, 7e producteur mondial d’électricité, peine a satisfaire le demande des miniers.
Ainsi, lorsque l’Eskom a proposé en début d’année d’augmenter les prix de l’électricité, les acteurs miniers sont montés au créneau pour montrer à quel point cela compromettrait l’avenir du secteur, déjà incertain. Baisse de production et perte de 150 000 emplois étaient les principaux arguments avancés par l’industrie minière pour justifier sa prise de position.
Pour cause, les mines consomment près du tiers de l’énergie distribuée dans le pays par la société nationale qui figure pourtant dans le top 7 mondial des compagnies électriques en matière de production.
Le même cas de figure s’est produit en 2017 en Zambie lorsque l’Etat a décidé d’augmenter les prix de l’électricité. Certaines compagnies minières, y compris des géants comme Glencore ou First Quantum Minerals, ont refusé de s’y conformer. Il s’en est suivi un bras de fer entre le gouvernement et l’industrie minière qui a abouti à la suspension de plusieurs opérations. Le différend a finalement été réglé au cas par cas, au bout de plusieurs jours de négociations, mais les quelques semaines de restrictions énergétiques dont ont été victimes les compagnies minières n’ont pas manqué d’affecter le volume total de cuivre produit par le pays.
Selon des prévisions de la Banque mondiale datant de 2015, les besoins énergétiques des mines en Afrique subsaharienne continueront d’augmenter pour atteindre les 23 GW, à l’horizon 2020.
Ces deux cas, loin d’être des exemples isolés, démontrent le caractère sensible de la question de l’accès à l’électricité pour les compagnies minières. D’une manière générale, le coût énergétique compte pour 10 à 35% du coût de développement d’un projet minier. Selon des prévisions de la Banque mondiale datant de 2015, les besoins énergétiques des mines en Afrique subsaharienne continueront d’augmenter pour atteindre les 23 GW, à l’horizon 2020. La demande viendra essentiellement de l’Afrique du Sud, mais également de pays comme la Zambie et le Mozambique, suivis des pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest. Mieux, dans certains pays, la demande d’électricité de l’industrie minière dominera celle de tous les autres secteurs.
Un contexte de déficit énergétique chronique
Pour les pays africains au sud du Sahara, l’accès à l’électricité est un problème épineux qui ne date pas d’aujourd’hui. Entre capacité de production insuffisante, faible connectivité, manque de fiabilité et coûts élevés, ces nations doivent faire face à des problèmes chroniques. Pourtant, le potentiel énergétique de la région a déjà été démontré par plusieurs études et recherches. Par exemple, seulement 8% du potentiel hydroélectrique du continent (environ 400 GW) ont été exploités. Les ressources gazières peuvent permettre à l’Afrique subsaharienne de produire chaque année 100 GW durant plus de 70 ans. Il faut ajouter à cela les vastes ressources de charbon, mais également les autres sources d’électricité, y compris les énergies renouvelables.
Dans certains pays africains, l’industrie minière demandera plus d’électricité que tous les autres secteurs réunis.
Malgré ce grand potentiel, quelque 600 millions d’Africains manquent encore d’une connexion électrique, selon les données d’un rapport de la BAD paru en septembre 2019.
Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, le nombre de personnes ayant accès à l’électricité ne dépasse pas les 10% de la population.
Si l’on se base sur de plus anciennes prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, citées par l’ONG britannique Oxfam, dans une étude réalisée en 2017, 489 millions de personnes n’auront toujours pas accès à l’électricité en 2040. « Il est important de se rappeler que les moyennes régionales et nationales peuvent occulter de vastes disparités dans les niveaux d’accès à l’énergie entre les pays et en leur sein », précise l'organisation qui note que dans certains pays d’Afrique subsaharienne, le nombre de personnes ayant accès à l’électricité ne dépasse pas les 10% de la population.
La capacité de production énergétique installée actuellement en Afrique subsaharienne dépasserait à peine les 80 GW, dont plus de 40 GW en Afrique du Sud. Le Nigeria, dont la population représente plus du triple de celle de l’Afrique du Sud, dispose seulement du dixième de sa capacité de production installée. De plus, dans des pays particulièrement riches en minerais comme la Guinée, la Mauritanie, le Mozambique, la RDC, la Tanzanie et la Zambie, les taux d'électrification dépassent à peine les 20-30%.
Les modes d’approvisionnement en électricité des mines
Pour satisfaire leurs besoins énergétiques, plusieurs options s’offrent aux compagnies minières. D’une manière générale, elles optent pour le raccordement au réseau. Cependant, ce mode d’approvisionnement présente plusieurs limites, notamment la sécurité et les tarifs élevés quand le réseau est alimenté par une coûteuse production à base de carburant.
L’auto-approvisionnemen t reste une solution coûteuse mais sûre (ici Sierra Rutile en Sierra Leone)
Dans un contexte où les réseaux n’arrivent même pas à satisfaire les besoins des populations, les compagnies minières commencent de plus en plus à opter pour l’auto-approvisionnemen t.
Dans un contexte où les réseaux n’arrivent même pas à satisfaire les besoins des populations, les compagnies minières commencent de plus en plus à opter pour l’auto-approvisionnemen t.
Cette option, en plus d’éliminer les risques de fiabilité, leur permet d’installer leur propre usine de production, selon les besoins de leurs projets. De 6% de projets miniers ayant recours à l’auto-approvisionnemen t, avant 2000 en Afrique subsaharienne, on devrait passer à 18% en 2020, malgré les coûts relativement très élevés.
« Il faut noter que les mines accordent au moins autant d'importance à la sécurité de l'approvisionnement qu'au coût. Elles investissent dans l'auto-approvisionnement, même lorsque le coût du kilowatt livré est beaucoup plus élevé, afin de conserver le contrôle de leur approvisionnement en électricité et d'en assurer la continuité », explique une recherche de la Banque mondiale sur le sujet.
Entre le raccordement aux réseaux nationaux et l’auto-approvisionnemen t, on retrouve plusieurs options intermédiaires, selon la typologie réalisée par l’institution. Si elles sont encore utilisées à petite échelle, certaines de ces options intermédiaires offrent l’avantage de prendre en compte les populations locales (voir Tableau). En effet, sur la base d’accords, souvent privés, les compagnies minières investissent dans les réseaux nationaux ou cèdent le reste de la capacité de leurs propres infrastructures de production aux réseaux.
Source : Banque mondiale
Comment les mines peuvent contribuer au développement du secteur énergétique
Dans son rapport intitulé « Le potentiel transformateur de l’industrie minière : une opportunité pour l’électrification de l’Afrique subsaharienne », la Banque mondiale indique que l’auto-approvisionnemen t représente des pertes pour l’économie, les entreprises énergétiques publiques, mais également pour les mines. « Si les mines délaissent l'auto-approvisionnement, les services d'utilité publique et la population en tireront aussi des avantages, et de nouvelles opportunités émergeront également pour le secteur privé », peut-on lire dans le document.
Lire aussi : 17/09/2019 - L’industrie minière africaine se convertit progressivement à l’énergie renouvelable
L’institution propose ainsi que le secteur minier serve de point d’ancrage de la demande dans des projets locaux d’électrification des pays riches en minerais. Les compagnies minières sont ainsi encouragées à investir avec les gouvernements, directement dans la production et le transport de l’électricité ou dans des sociétés de production indépendantes pour lesquelles ils serviront d’acheteurs principaux. Ce cas de figure leur permettrait d’économiser des centaines de millions de dollars et permettrait d’approvisionner les communautés locales.
Les compagnies minières sont ainsi encouragées à investir avec les gouvernements, directement dans la production et le transport de l’électricité ou dans des sociétés de production indépendantes.
En Guinée ou en Mauritanie, par exemple, où plusieurs scénarios ont été simulés, il s’avère que l’approvisionnement partagé par plusieurs mines et l’approvisionnement partagé par les mines et les communautés avoisinantes sont les options les plus rentables et bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Dans le cas de la Guinée, l’intégration énergie-exploitation minière a la capacité de raccorder environ 5% de la population au réseau d’électrification. Ce taux s'élève à 4% pour la Mauritanie.
Dans le cas de la Guinée, l’intégration énergie-exploitation minière a la capacité de raccorder environ 5% de la population au réseau d’électrification. Ce taux s'élève à 4% pour la Mauritanie.
Toutefois, cette intégration présente plusieurs contraintes techniques et financières. En premier lieu, le grand risque que représente une coopération étroite avec des sociétés publiques pour les compagnies minières. En effet, plusieurs entreprises énergétiques publiques traversent régulièrement des difficultés financières. C’est le cas de la Tanesco (Tanzanie), de l’Eskom (Afrique du Sud), mais également dans des pays comme la RDC ou la Zambie.
Une volonté politique
Il ne fait aucun doute qu’une coopération plus étroite entre l’industrie minière et le secteur public, sur le plan énergétique, malgré les risques, a un énorme potentiel pour les pays d’Afrique subsaharienne. Le potentiel est d’autant plus grand quand on sait que la région héberge une partie importante des réserves mondiales de matières premières stratégiques. A titre d’illustration, dans les 48 pays d’Afrique subsaharienne, plusieurs font partie des plus grands producteurs mondiaux d’or (le Ghana, le Soudan, l’Afrique du Sud, le Mali, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire ou encore le Burkina Faso). La RDC est le premier producteur de cobalt au monde, et avec la Zambie, l’un des plus grands producteurs de cuivre. Ajoutons à cela la concentration des réserves mondiales de métaux du groupe du platine en Afrique du Sud, mais également les grandes richesses en uranium, en bauxite, en charbon du continent.
La compétitivité du solaire devrait favoriser l’intégration des besoins miniers dans l’élaboration des politiques nationales.
Dans la plupart des pays susmentionnés, l’industrie minière est l'un des plus importants contributeurs aux exportations, recettes fiscales et produit intérieur brut (PIB), mais profite très peu aux populations elles-mêmes. Les populations de ces nations sont parmi les plus pauvres au monde.
Pour renverser cette tendance et concrétiser le potentiel de cette richesse minérale pour l’électrification, il faudrait déjà que les Etats africains manifestent de la volonté en commençant par intégrer les besoins du secteur minier à leurs feuilles de route énergétiques. Actuellement, la Tanzanie est l’un des rares pays à le faire sur le continent. Ensuite, l’instauration d’un cadre de dialogue et de travail sur la question permettrait de rassurer les compagnies minières et les encourager à investir directement dans la production et le transport d'électricité ou devenir des clients de référence pour des producteurs indépendants privés.
L’instauration d’un cadre de dialogue et de travail sur la question permettrait de rassurer les compagnies minières et les encourager à investir directement dans la production et le transport d'électricité ou devenir des clients de référence pour des producteurs indépendants privés.
Une chose est certaine, pour relever le défi énergétique, l’Afrique subsaharienne doit mobiliser toutes les ressources qui s’offrent à elle. Faute de quoi, des centaines de millions de personnes n’auront pas accès encore à l’électricité dans les prochaines décennies, et les économies africaines ne parviendront toujours pas à se faire leur place sur l’échiquier mondial.
Le méthane de houille ou gaz de houille (CBM) est ce combustible qu’on retrouve en surface des mines de charbon, avant le début de l’exploitation minière. Chargé jusqu’à 90% de méthane, il entrainait autrefois des explosions dans les mines de charbon. Plus tard, vers la seconde moitié du XXe siècle, la technique de dégazage des mines a permis de réduire considérablement les risques liés à ces accidents.
Et depuis près de 40 ans, le combustible est utilisé dans la production d’électricité. Etant donné que l’Afrique fournit 4% de la production mondiale de charbon, le combustible offre une chance à plusieurs pays du continent de réduire leurs difficultés d’approvisionnement électrique, de diversifier le bouquet énergétique et d’éliminer un gaz terriblement nocif pour le climat.
Etat des lieux
Le gaz de houille constitue, pour plusieurs régions du monde, une ressource susceptible de renforcer la sécurité d’approvisionnement gazier / électrique et la compétitivité industrielle. Actuellement, c’est une énergie, qui pèse moins de 1% dans le mix énergétique mondial. C’est aussi une alternative nouvelle qui, jusqu’ici, a fait l’objet de très peu de recherches par rapport à ses concurrentes. « Bien que la part du méthane de houille dans le mix énergétique total soit encore modeste, il possède un énorme potentiel pour l'avenir », fait remarquer la société parapétrolière américaine Halliburton.
« Bien que la part du méthane de houille dans le mix énergétique total soit encore modeste, il possède un énorme potentiel pour l'avenir », fait remarquer la société parapétrolière américaine Halliburton.
Pour le célèbre ingénieur en géophysique américain Joe Awny, « le CBM pourrait un jour se développer pour devenir, non plus un simple complément au gaz naturel conventionnel, mais une source principale de gaz. Il aura probablement une importance majeure pour les Etats-Unis, la Chine, le Canada, la Russie, l’Inde la Pologne, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, ainsi que pour d’autres pays, en tant que principale source d’approvisionnement en gaz ». Les trois premiers pays cités plus haut contrôlent à eux seuls 80% des réserves mondiales de CBM et en sont les principaux producteurs.
« Un énorme potentiel pour l'avenir. »
La première production d’électricité avec le gaz de houille a été faite aux Etats-Unis, dans les bassins de San Juan et Black Warrior. Il importe de souligner que le CBM est considéré, au même titre que le schiste, les sables bitumineux ou encore les hydrates de méthane, comme étant une énergie non conventionnelle. Vu que sa composition en gaz est normalement stable, le CBM peut toutefois, être directement injecté dans des centrales électriques à gaz ou dans des réseaux de distribution de gaz.
Des avantages non négligeables
L’exploitation du méthane de houille est une façon plus saine d’éliminer le méthane sans polluer l’environnement, tout en l’employant simultanément comme une source d’énergie. Il faut savoir que les rejets de méthane dans l’atmosphère ont un potentiel de réchauffement 23 fois plus élevé que celui du CO2.
Il faut savoir que les rejets de méthane dans l’atmosphère ont un potentiel de réchauffement 23 fois plus élevé que celui du CO2.
Le forage dirigé, qui est la technique employée dans ce cas, permet à la plateforme de creusage de se recourber en suivant la veine de charbon sur plusieurs centaines de mètres au sein de la mine. Cela entraîne, par conséquent, une augmentation de 10 à 20 fois de la productivité par rapport à un forage vertical sollicité dans le pétrole par exemple. Le nombre de puits en surface est ainsi réduit de même que les coûts de production.
Autrefois appelé le grisou, le méthane de houille a tué de nombreux mineurs partout dans le monde.
Selon les experts, comparativement aux autres énergies conventionnelles, le méthane de houille offre une profitabilité de 43,4% pour ce qui est de la production d’électricité. Cela devrait interpeller les pouvoirs publics africains qui présentent la faiblesse des moyens financiers comme l’une des principales causes du déficit de l’offre électrique sur le continent.
Comparativement aux autres énergies conventionnelles, le méthane de houille offre une profitabilité de 43,4% pour ce qui est de la production d’électricité. Cela devrait interpeller les pouvoirs publics africains.
Il importe de noter que l’utilisation du gaz de mine dans des moteurs à gaz de référence Jenbacher (fabriqués par General Electric) peut réduire l'émission de méthane dans l'atmosphère d'environ 85% par rapport à l'aération du gaz, ce qui correspond à des économies de CO2 de 30 à 40 000 tonnes / an. Ce constat a été publié par Clarke Energy, leader mondial de la production d’électricité via CBM.
L’utilisation du gaz de mine dans des moteurs à gaz de référence Jenbacher peut réduire l'émission de méthane dans l'atmosphère d'environ 85% par rapport à l'aération du gaz.
En Australie, Clarke Energy produit plus de 1,5 million de MWh d'électricité par an avec du CBM, ce qui est suffisant pour alimenter en énergie environ 430 000 foyers. La production de cette quantité d'électricité avec du gaz de mine permet d'économiser environ 367 millions de mètres cubes de gaz naturel par an, ajoute la société.
L’Afrique, un marché vierge, mais en ébullition
Si l’Afrique est le seul continent au monde à ne pas compter de centrales électriques fonctionnant au CBM, l’exploration en amont, quoiqu’embryonnaire, connait beaucoup de progrès et présente d’alléchantes perspectives pour l’avenir.
D’ici 2025, environ 700 millions de dollars seront injectés dans le secteur.
Selon un rapport de Global Data, en Afrique, au sud du Sahara, la production de gaz enregistrera une hausse de 18%, d’ici les trois prochaines années, pour atteindre 9,1 milliards de pieds cubes par jour. Selon la répartition, plus de 6,4 milliards de pieds cubes proviendront de projets conventionnels ; 2,6 milliards de pieds cubes représenteront la production des champs non conventionnels et de gaz associés et 8,5 millions de pieds cubes viendront de projets de méthane de houille, notamment en Afrique australe (Botswana, plus précisément).
Par ailleurs, Peter Heath, analyste du marché du pétrole et du gaz pour la région Afrique chez Global Data, a fait savoir que, d’ici 2025, environ 700 millions de dollars seront injectés dans le secteur.
Les recherches qui se sont accentuées au cours des dix dernières années, sont majoritairement concentrées en Afrique australe et couvrent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Malawi et le Zimbabwe.
Les recherches qui se sont accentuées au cours des dix dernières années, sont majoritairement concentrées en Afrique australe et couvrent l’Afrique du Sud, le Botswana, le Malawi et le Zimbabwe.
En Afrique du Sud, le secteur de l’exploration de CBM est resté assez dynamique entre 2012 et 2015. Pendant cette période, le gouvernement a octroyé plusieurs licences d’exploration et des études ont été réalisées dans la région de Springbok Flats, dans le bassin du Limpopo. La zone accueille plusieurs autres projets miniers.
Mais depuis le début de la chute des prix du pétrole, l’activité exploratoire tourne au ralenti. Cependant, les analystes tablent sur une reprise prochaine des activités grâce à l’amélioration progressive des prix de l’or noir et surtout grâce à la volonté du gouvernement de diversifier les sources de production d’électricité. L’Afrique du Sud qui est le principal producteur de charbon en Afrique compte profiter de cette opportunité pour doper sa production électrique.
Le potentiel africain du CMB se concentre beaucoup sur l’Afrique du Sud, le Botswana, le Malawi et le Zimbabwe.
Au Botswana, depuis le début des années 2010, le gouvernement a octroyé une dizaine de licences d’exploration de CBM. La compagnie australienne Tlou Energy, qui est la plus active du pays, détient 100% de parts dans dix blocs d’exploration. Elle a signalé, en février 2018, un potentiel de 40,8 milliards de pieds cubes de CBM sur ses principaux projets Lesedi et Mamba. On estime qu’après une cartographie complète des sites, cette estimation serait probablement revue à la hausse.
La compagnie australienne Tlou Energy, qui est la plus active du pays, détient 100% de parts dans dix blocs d’exploration. Elle a signalé, en février 2018, un potentiel de 40,8 milliards de pieds cubes de CBM sur ses principaux projets Lesedi et Mamba.
En juin 2017, l’entreprise a réussi à produire pour la première fois de l’électricité à partir du méthane de houille. Près de deux ans plus tard, en mai 2019, elle a obtenu une autorisation du gouvernement pour installer une centrale de 100 MW. Ce projet est prévu débuter par une capacité initiale de 10 MW. Il faut rappeler que plus tôt, en 2015, Tlou a démarré des négociations avec les autorités botswanaises et les différentes parties prenantes pour fournir du gaz à deux centrales électriques. Il s’agit de la centrale électrique Orapa de 90 MW et d’une centrale de 300 MW que développeront General Electric et la compagnie australienne IK Holdings.
Au Malawi, le secteur est depuis 2009 à la phase des relevés sismiques sur ses périmètres d’exploration. Néanmoins, deux compagnies restent très actives. Il s’agit d’une part de NuEnergy Gas qui contrôle des actifs en Indonésie et en Afrique, avec une licence exclusive de prospection dans le district de Chikhwawa, dans le sud du pays. D’autre part, il y a Aranos Gas Limited, une joint-venture entre deux firmes namibienne et sud-africaine. Selon des campagnes géologiques, le pays détiendrait des réserves de plusieurs millions de tonnes de charbon dans le bassin d’Aranos, un potentiel jusqu’ici ignoré par les compagnies minières. Une occasion que compte saisir la JV pour produire du CBM pour l’électricité.
Quant au Zimbabwe, la société publique des mines, la Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) a lancé, fin 2017 - pour la première fois dans l’histoire du pays - des appels d'offres pour l'exploration et le développement du méthane de houille dans une région prometteuse du nord-ouest du pays, qui devrait abriter plus d'un milliard de mètres cubes de CBM, soit l’une des plus grosses estimations d’Afrique australe. En juillet 2019, la société américaine General Electric a annoncé qu’elle envisage d'explorer des gisements de gaz naturel et de méthane de houille dans les régions de Hwange-Binga-Lupane, et de Chiredzi. Plus tôt en février, la société sud-africaine Tumagole Consortium a dévoilé un plan de 4 milliards de dollars visant à développer des ressources de CBM dans l’ouest du Zimbabwe, précisément dans la région de Lupane.