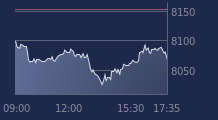(BFM Bourse) - Alors qu'il était en pleine ébullition en 2020 et 2021, le secteur de l'hydrogène vert a connu une véritable descente aux enfers boursiers, avec des actions en chute libre voire des liquidations judiciaires. Les financements et les projets ont pris du retard et les acteurs, fragiles pour la plupart, ont mal encaissé le choc.
En Bourse, il existe des thématiques sur lesquelles les doux rêves du marché se fracassent parfois violemment sur le mur de la réalité. Citons à titre d'exemple la viande végétale, avec l'entreprise américaine Beyond Meat, qui a dépassé les 12 milliards de dollars de capitalisation boursière avant de voir son cours de Bourse être divisé par plus de 70.
L'hydrogène et plus exactement l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit par électrolyse avec de l'électricité issue d'énergies renouvelables, par opposition à l'hydrogène gris, généré à partir d'énergies fossiles, illustre bien ce type de correction ultra-violente.
>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading
Fin 2020, McPhy spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène décarboné, rejoint le SBF 120, le deuxième plus important indice de la Bourse de Paris. Le groupe a alors vu son cours s'envoler de plus de 700% sur la seule année 2020. Quelques mois plus tard, HRS (pour "Hydrogen-Refueling-Services"), spécialisé dans les stations de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules, s'introduit en fanfare à la Bourse de Paris, l'action prenant plus de 20%. Hydrogène de France, producteur d'hydrogène vert, rejoindra également la cote parisienne peu de temps après, levant plus de 130 millions d'euros.
Quelques années plus tard, la donne a radicalement changé. HRS a vu son cours de Bourse être divisé par 13 par rapport à ses sommets de 2021, Hydrogène de France par sept. Pour McPhy, la situation est pire. À court de trésorerie, le groupe a annoncé mi-mai qu'il serait placé en liquidation judiciaire et, logiquement, radié de la cote.
Les difficultés ne se limitent pas aux pure-players de l'hydrogène. GTT, une entreprise appréciée du marché et des analystes, a annoncé en début d'année que sa filiale Elogen, spécialisée dans les électrolyseurs pour la conception et la fabrication d'hydrogène vert, serait "réorientée" avec à la clef 110 suppressions de postes. Cette entreprise n'avait obtenu aucune commande significative en 2024 et avait accusé une perte brute d'exploitation de 33 millions d'euros. Hyvia, une filiale de Renault spécialisée dans la mobilité à hydrogène vert a, elle, été placée en liquidation judiciaire en février.
Exubérance et retour de bâtons
Comment expliquer un tel retournement? "Lors des années 2020-2021, les différents secteurs liés à la transition énergétique, comme l'hydrogène mais aussi des technologies plus matures (solaire, éolien terrestre) étaient très en vogue sur le marché, notamment pace que les taux d'intérêt bas favorisaient les projets dans ces secteurs", rappelle Tancrède Fulop, analyste chez Morningstar.
"Depuis, les technologies d'énergies renouvelables plus matures que l'hydrogène, comme l'éolien, ont sous-performé le marché, et c'est un euphémisme. Cette correction a été encore plus forte sur l'hydrogène, une technologie plus spéculative, plus dépendante aux subventions, et avec une efficacité limitée", poursuit-il.
"Par exemple le modèle allemand prévoyait d'utiliser les renouvelables pour ensuite alimenter des électrolyses et donc produire de l'hydrogène vert qui devait ensuite être stocké pour aller vers des turbines à gaz compatibles avec l'hydrogène. On s'est rendu compte que ce procédé induisait beaucoup de pertes d'énergie et que le modèle économique était très cher", ajoute le spécialiste.
Nicolas Royot, analyste chez Portzamparc, rappelle que l'argent coulait autrefois à flot dans un contexte d'optimisme prononcé."Il y a eu une phase d'exubérance du marché en 2020-2021 qui a été déclenchée par un début de politique européenne très ambitieuse en matière d'énergies renouvelables et notamment d'hydrogène vert, alors que l'on partait de très bas, avec très peu d'acteurs. Forcément, tous les capitaux se sont rués vers les mêmes sociétés cotées", souligne-t-il.
"D'autant qu'en parallèle, les fonds ESG (environnement, social, gouvernance: les critères extra-financiers, NDLR), avaient le vent en poupe et collectaient énormément d'argent. Il fallait investir cette manne, qui est donc allée à une poignée de groupes spécialisés dans l'hydrogène, puisque l'on attendait un boom du secteur. Ce alors que ces sociétés étaient peu matures", détaille l'analyste.
"On a vécu un moment assez irrationnel, avec des montants importants promis à un petit nombre d'acteurs de taille modeste avec des modèles économiques incertains. Des dizaines voire des centaines de milliards d'euros d’investissements ont été annoncés par l’Union européenne et différents pays (France, Allemagne, Espagne, Portugal…) pour parvenir à ce que l'hydrogène vert représente 12% à 14% du mix énergétique de l'Europe en 2050, contre moins de 2% actuellement. L'emballement était énorme", souligne-t-il encore. Nicolas Royot juge ainsi qu'une bulle s'était créée.
Une Europe trop ambitieuse
Un exemple marquant. Lors de son introduction en Bourse en 2021, HRS avait drainé une demande de plus de 400 millions d'euros, dont plus de 90 millions d'euros de la part des particuliers. "Seul FDJ a dû faire mieux. Aujourd'hui, trouver 90 millions d'euros tout compris (particuliers et institutionnels ensemble) lors d'une introduction en Bourse pour une petite ou moyenne valeur serait déjà un très beau succès", pointe l'analyste de Portzamparc.
"Quatre-cinq années plus tard, nombre de ces projets (européens, NDLR) et plans d'investissements ont pris du retard pour des raisons administratives et financières. Les financements promis ont été moins nombreux qu'espéré. Et chaque subvention doit être validée au niveau européen puis répercutée sur le plan national avant de pouvoir lancer le projet, ce qui forcément prend du temps", poursuit-il.
Le marché a donc été trop optimiste, de même que les États et les gouvernements. Une étude du cabinet EY de janvier dernier soulignait que les objectifs ambitieux du plan européen "RePowerEU", à savoir la production de 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable en 2030, implique des capacités de 100 gigawatts d'électrolyseurs au même horizon. Ce qui suppose un taux de croissance annuel moyen de 150% entre 2025 et 2030, soit trois fois plus que sur la période 2020-2024. La même étude soulignait que 98% des 142 gigawatts de projets d'hydrogène annoncés en Europe se trouvaient au stade de concept ou d'étude de faisabilité.
La France a d'ailleurs acté en avril un abaissement de ses ambitions dans sa stratégie d'hydrogène bas carbone, avec des capacités de 4,5 gigawatts d'électrolyseurs prévues en 2030, contre 6,5 gigawatts précédemment, puis 8 gigawatts en 2035, contre 10 gigawatts initialement.
"L'élaboration de la politique européenne en matière d'hydrogène a été critiquée dernièrement, les préoccupations portant généralement sur les objectifs de consommation d'hydrogène à long terme jugés irréalistes, ainsi que sur le soutien financier fragmenté et insuffisant", écrivait Royal Bank of Canada en février. La banque évoquait aussi certaines règles "trop compliquées" ou "trop complexes".
Des soucis politiques
Outre les problèmes liés à la mise en œuvre de ces projets, Nicolas Royot estime que des "des enjeux politiques ont également pu entrer en compte". "À un moment donné, la question de savoir si l'hydrogène produit avec des électrolyseurs alimentés par de l'électricité elle-même générée via l'énergie nucléaire, rentrait dans le champ de l'hydrogène vert. Ce type d'incertitude réglementaire a occasionné des retards", explique-t-il.
"En France, la dissolution a retardé de 6 à 12 mois la finalisation d’une grosse subvention pour un projet majeur de Lhyfe (un producteur d'hydrogène vert coté en Bourse, NDLR) de 149 millions d'euros, soit plus de 50% du coût du projet, qui avait été validée par l'Union européenne mais qui attendait la signature du Premier ministre", ajoute-t-il.
"Tout cela a fait que les acteurs de l'hydrogène n'ont pu enclencher le cercle vertueux qu'ils espéraient créer: les subventions publiques entraînent une hausse des volumes ce qui permet de baisser les prix et de créer un écosystème pérenne", expose l'analyste.
"McPhy, par exemple, avait mené une augmentation de capital massive (180 millions d'euros) notamment sur la base d’un contrat espéré pour un projet important de 20 mégawatts aux Pays-Bas pour lequel ils avaient été retenus. Mais ce projet n'a pas suffisamment avancé et finalement n’est jamais sorti", illustre Nicolas Royot. "L'argent des subventions a par ailleurs été parfois mal investi. La France avait prévu des subventions maximales de 114 millions d'euros pour la gigafactory de McPhy, un acteur qui devait encore largement faire ses preuves. La gigafactory n'aura, au final, presque jamais servi", conclut l'analyste.
Le problème ne se limite pas à l'Europe. L'an passé, l'IFP Énergies nouvelles notait, sur la base des données de Bloomberg, que près de 75% des projets mondiaux d'hydrogène (en très grande majorité de l'hydrogène vert) étaient confrontés à des retards liés aux coûts de financement et de matériel ainsi qu'au manque de clarté de la réglementation ou encore de l'absence de maturité technologique. L'institut de recherche estimait que le marché était "encore en gestation".
Une éclaircie?
Les entreprises européennes d'hydrogène cotées ont, par ailleurs, eu du mal à faire leurs preuves. Royal Bank of Canada estimait en janvier que l'allemand Thyssenkrupp Nucera était le seul producteur européen d'équipements à avoir démontré qu'il était capable d'exécuter sans accroc des projets de grande envergure.
"Les entreprises du secteur ont, elles, rencontré des problèmes techniques. Ces acteurs n'avaient pas de marché de masse et une expertise seulement sur des petits électrolyseurs, de quelques mégawatts quand les ambitions européennes nécessitent des capacités à 100, 300 mégawatts. Ce qui demandait un changement d'échelle conséquent, compliqué techniquement et économiquement, alors qu'il fallait en même temps abaisser les coûts", explique Nicolas Royot.
"La conjoncture de ces éléments a fait que la bulle a éclaté. Les valorisations se sont effondrées et l’appétit des investisseurs s’est amoindri: il est aujourd’hui plus difficile de lever de l’argent sur les marchés financiers pour des acteurs de l’hydrogène. Cette situation pousse des acteurs à faire évoluer leur stratégie, comme Lhyfe qui chercher à faire rentrer des fonds d’investissements directement au capital de projets ou de portefeuille de projets", constate-t-il.
L'analyste note toutefois quelques signaux récents encourageants. "Les perspectives réglementaires s’améliorent enfin, les politiques pour soutenir le développement de l’hydrogène vert se structurent: transformation en lois nationales de la réglementation européenne (RED 3, objectifs 2030) en 2025, systèmes d’appels d’offres mis en place et industrialisés dans certains pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne), programmes de subventions sur le kilogramme d’hydrogène produit (à venir en France) et sur le long terme, et plus uniquement sur les capex, appels d’offres de la Hydrogen Bank", énumère Nicolas Royot.
Par ailleurs, certains acteurs tirent un peu leur épingle du jeu. Citons Lhyfe, groupe français coté qui, certes, souffre sur trois ans en Bourse, avec une action en baisse de 62%, mais moins que HRS ou Hydrogène de France qui accusent des plongeons de plus de 80%. La société est, avec le britannique ITM Power, la valeur préférée du secteur de Royal Bank of Canada.
"Lhyfe demeure un cas particulier: ce n’est pas un fournisseur d’équipements mais un producteur d’hydrogène vert, ensuite vendu chez des acteurs de la mobilité ou des grands clients industriels chez qui ils installent des unités de production. Le groupe utilise les électrolyseurs fournis par des entreprises comme l'américain Plug Power, un acteur fiable. Ce qui leur permet d'être agnostique sur le plan technologique et de présenter un profil moins risqué que d'autres acteurs, malgré une activité plus capitalistique. Leur métier est de développer le projet de A à Z, de trouver le client final, la bonne technologie, de contractualiser les prix de l'électricité et d’exploiter l’unité de production dans la durée", explique Nicolas Royot
"Ils ont, comme les autres acteurs, pris du retard mais ils ont quelques unités de production, de taille croissante, qui fonctionnent bien et des gros projets de plus de 100 mégawatts qui progressent", conclut l'analyste.
Recevez toutes les infos sur MCPHY ENERGY en temps réel :
Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse
Par email